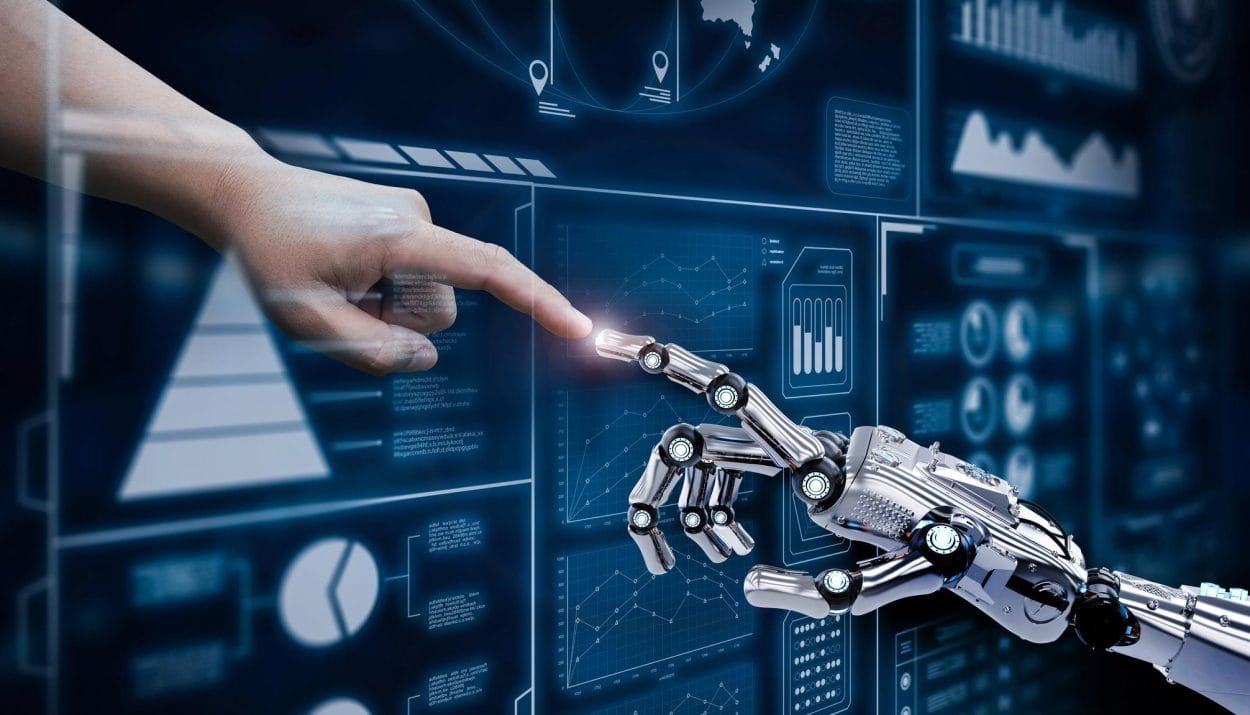L’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) ne se limite pas à une quatrième révolution industrielle : elle représente une rupture potentielle, un changement profond qui remodèle les sociétés, les structures et les paradigmes humains. Ce qui n’était autrefois qu’un simple outil émergent imprègne désormais tous les domaines — de la gouvernance aux soins de santé — transformant la vie quotidienne et suscitant des débats éthiques urgents. L’analyse de la professeure Naciye Selin Senocak, politologue et titulaire de la chaire UNESCO de diplomatie culturelle, de gouvernance et d’éducation, est particulièrement intéressante car elle déconstruit le pessimisme ambiant quant à l’impact des technologies sur nos sociétés.

"Au cœur de cet essor technologique, l'incertitude règne : l’IA continuera-t-elle d’être une extension des capacités humaines, ou pourrait-elle remettre en question et redéfinir l’autonomie et le sens de l’être humain ?
À travers son article, l’auteure parcourt... “le spectre des perspectives sur le rôle de l’IA dans la modernité, explorant si elle annonce une nouvelle civilisation dans laquelle les algorithmes ne servent pas seulement l’être humain, mais façonnent également son destin”.
En examinant de manière critique ces points de vue, elle cherche à comprendre le potentiel de l’IA à élever ou affaiblir les aspects fondamentaux de la civilisation : “nos valeurs, notre gouvernance et notre avenir commun”.
Et Selin Senocak pose les questions qu’elle considère comme essentielles :
Selon l’auteure, l’optimisme entourant le potentiel des machines intelligentes ne doit pas occulter les risques importants qu’elles peuvent représenter pour l’avenir de notre espèce.
« L’expansion des sciences naturelles a progressivement absorbé de nombreuses branches de la philosophie ; cependant, l’éthique reste indispensable, conservant une autonomie épistémologique unique. »souligne Seline Senocak.
Selon elle, « Cette autonomie soulève une question fondamentale pour les éthiciens, sociologues et théologiens : si l’humanité venait à créer une conscience artificielle — une forme d’intelligence surpassant l’intellect humain —, qu’est-ce qui, le cas échéant, resterait spécifiquement humain ? »
« Existe-t-il une fonction ou une essence propre à notre espèce, quelque chose qui ne puisse être reproduit ni remplacé par des moyens artificiels ? »
Avec cette question, l’auteure souligne la nécessité cruciale d’une réflexion philosophique et éthique rigoureuse sur les défis posés par le progrès technologique.
Inévitablement, affirme-t-elle, l’influence omniprésente de la technologie génère un certain degré de scepticisme, « ce qui incite à approfondir les recherches sur ses implications pour l’identité et la finalité humaines. »
Seline Senocak considère qu’il est essentiel d’établir des lois intelligentes et soigneusement élaborées pour protéger l’humanité, de plus en plus étroitement liée à ses créations artificielles.
« Cette relation exige une application réfléchie de l’imagination et de la créativité dans nos interactions avec les machines, une application qui évite les récits apocalyptiques et les affirmations grandiloquentes et infondées, telles que les prédictions d’un chômage généralisé, qui manquent de base empirique solide. »
En effet, soutient l’auteure, « L’impact des avancées technologiques sur l’emploi dépendra en grande partie de la manière dont nous structurerons et adapterons nos systèmes économiques, car les nouvelles technologies créent inévitablement de nouvelles demandes et opportunités professionnelles. »
Source de l'article : l'observateur